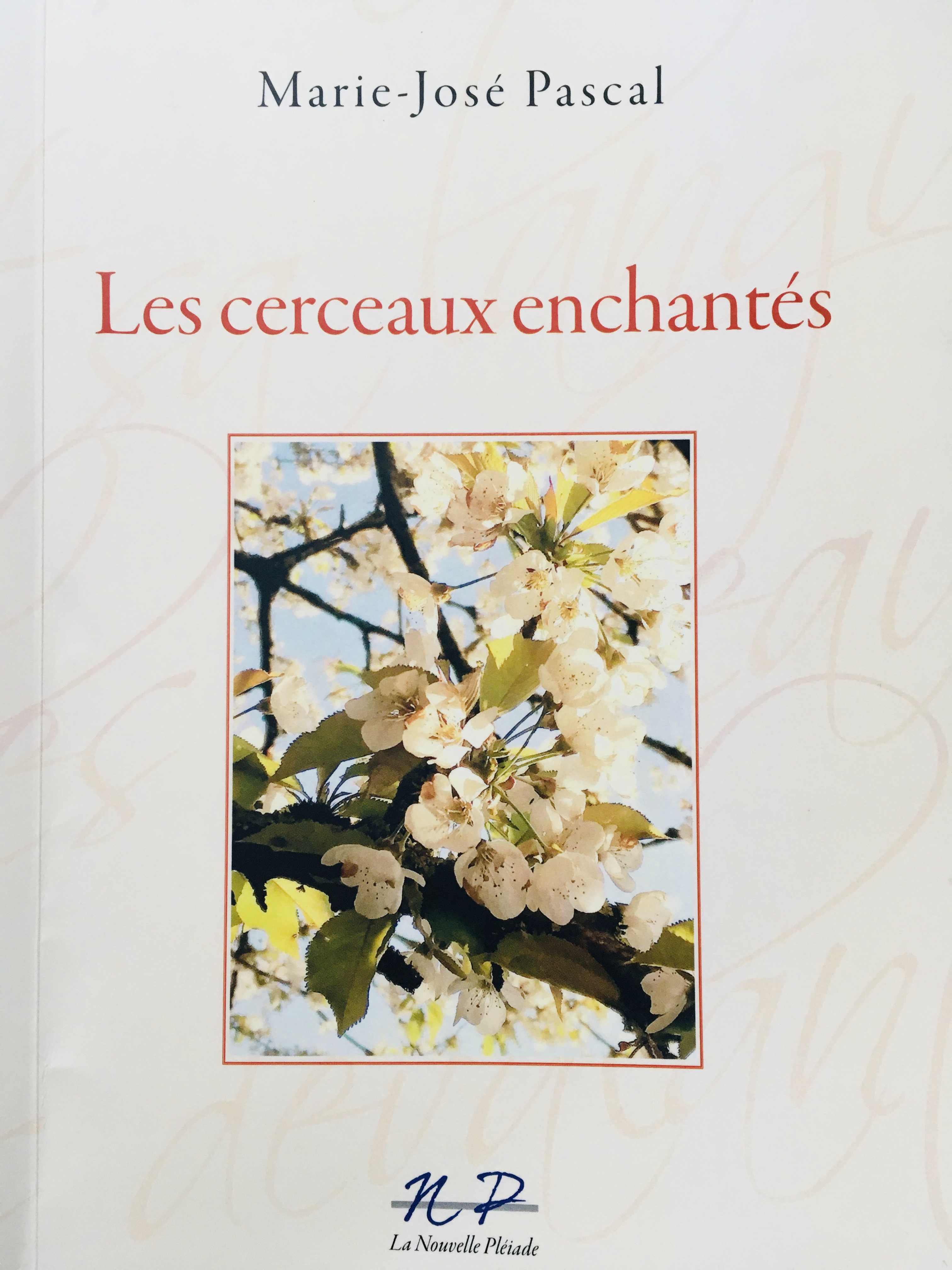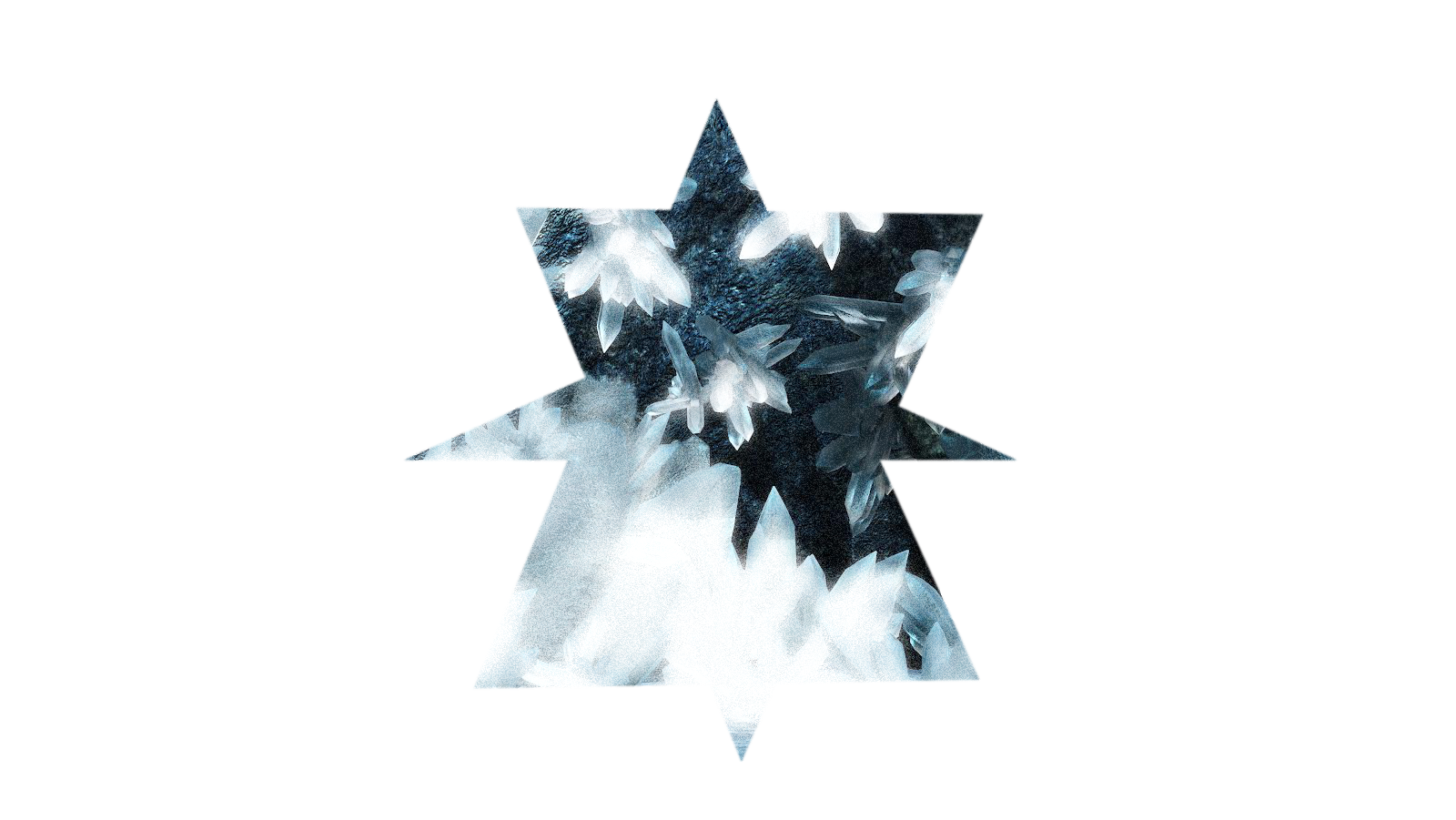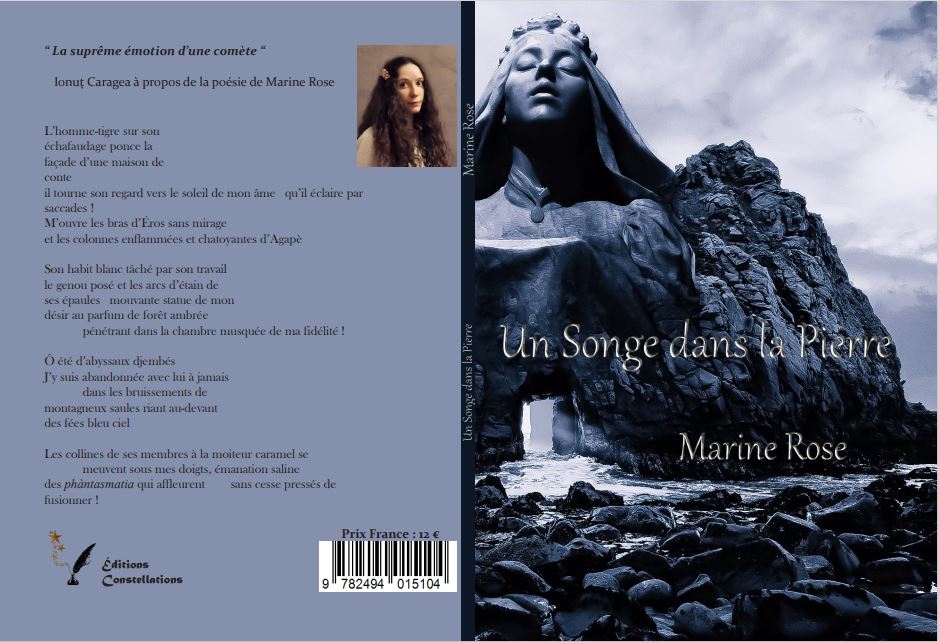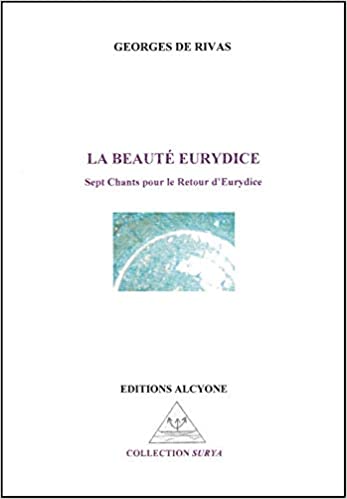Publié le
Les cerceaux de L'Enfance Poétique
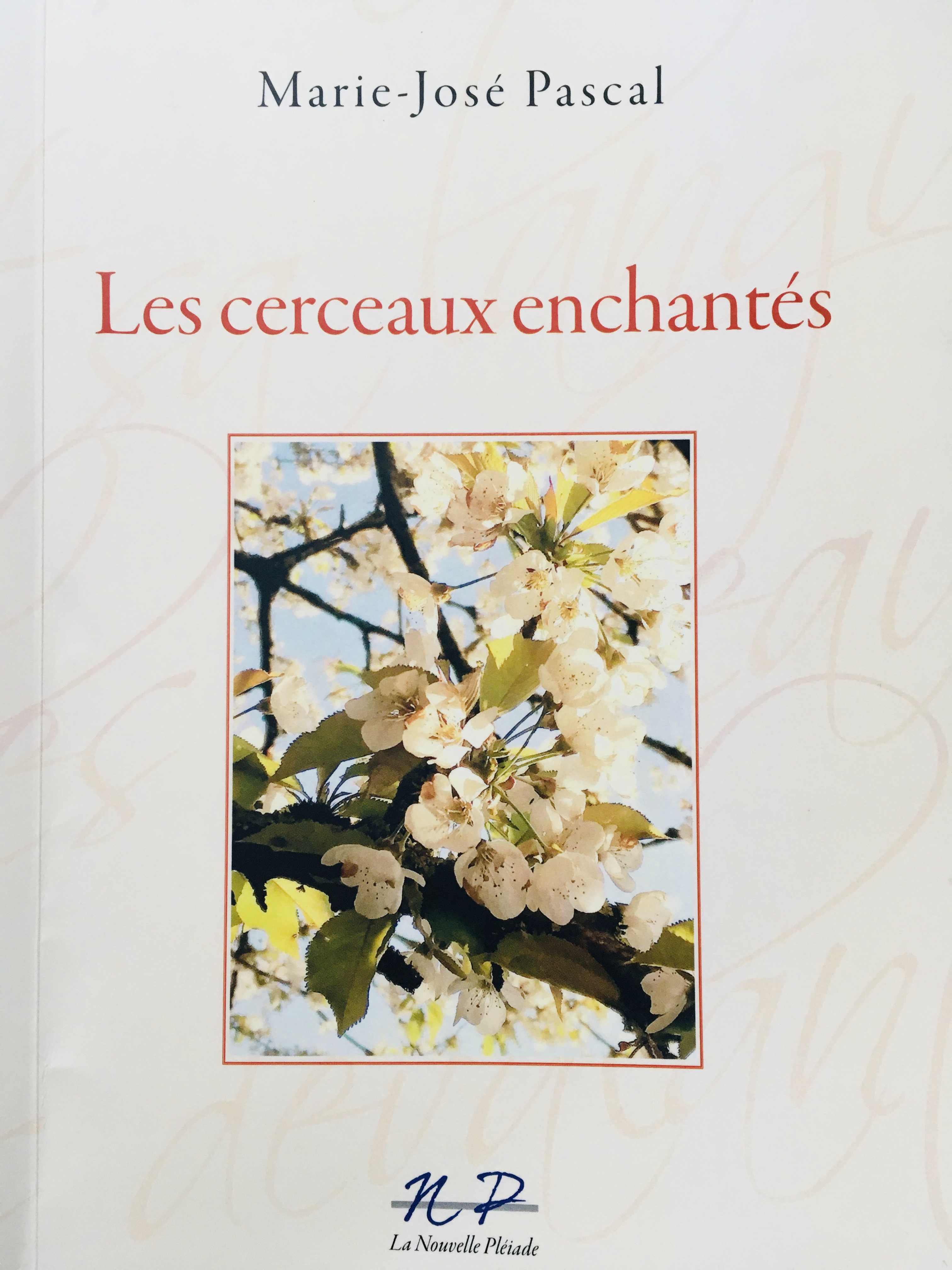
Refléter la simplicité numineuse de l’enfance n’est pas chose aisée. Pourtant, selon Carl Gustave Jung
« L’accès au numineux est la seule véritable thérapie ». Cela suppose aussi de revenir à une
primordiale humilité.
Dans quelles vies respire le mieux ce « sentiment de présence absolue, une
présence divine »(Rudolf Otto) sinon au sein de celles des enfants et des saints ? Le poète, qui n’est
plus tout à fait enfant et n’est encore immergé dans une vie unitive immaculée qui serait la
répétition parfaite de l’enfance en plus d’être sa transcendance (ou d’une Origine encore plus
sacrée), peut naviguer entre deux eaux : celle de la nostalgie et celle de l’Aspiration.
Là peut jaillir
« un monde autre et même » (Michael Edwards), la proposition vive d’une harmonie propre tant à
l’initiation suggestive « hors des sentiers battus » qu’à une Souvenance animée par une espérance
poétique.
Dans le recueil de poésie libérée « Les cerceaux enchantés » (édité par La Nouvelle Pléiade) Marie-
José Pascal dit d’emblée :
« Le cœur ne vieillit pas. / Quand il est magicien et qu’avec des « riens »/ il peut réinventer les
cerceaux enchantés »
J’y ai noté un champ lexical de la nature épuré voire ingénu : « arbre »,
« oiseau », « pierres », « herbes », « la colline », « soleil », (« chaque chose »)… révélateur d’une
volonté de revenir aux sources d’un regard nouveau et par-là même forcément modeste et étonné.
Car le monde de l’enfance est évidemment celui où l’on fait peu à peu sienne une étrangère : la
parole et où l’on nomme assez indistinctement. Et pourtant, déjà, se révèle le « Pouvoir étonnant de
l’imagination / Qui transforme un banc ordinaire / En une barque vive ».
L’« espérance poétique » évoquée plus haut ne pourrait-elle être celle, notamment, qui confond les
temps, les sensations et émotions perdues :
« Je suis retournée au pays de l’enfance […] / Et les rires ingénus masquent les éclats de voix. /
J’aurais tant voulu y rester ! »
avec celles trouvées par les sonores contes et métaphores :
« […] la petite fille attirée par la lumière / D’un réverbère en transes, regarde/ Sur l’écran de verre se
refléter la nuit. / Le ciel valse avec les étoiles, / Au son d’une musique imperceptible / Et douce. »
aussi celles retrouvées par les mélodies qui parfois se font pont entre deux rives habitées
simultanément ?
« Le piano silencieux s’est remis à vibrer
Sous les doigts de l’enfant qui l’a ressuscité
Écoutez ! Écoutez encore : Les valses de Chopin
Sur les touches blanches et noires,
Flottent tel un parfum subtil :
De pluie, d’exil et de mélancolie »
Notons en parenthèse que la mémoire musicale est l’une des plus puissantes qui soit, cela se
constate chez des personnes atteintes d’Alzheimer. Ainsi, une danseuse en fin de vie amnésiée par la
maladie s’est soudain animée des mouvements d’une chorégraphie maintes fois répétée en sa
jeunesse à l’écoute de la musique du Lac des cygnes de Tchaikovsky.
La Souvenance est aussi animée par le recul gagné par l’expérience, faisant réapparaître l’enfance
sous un jour nouveau. Les mots, témoins passés et présents, se déposent ainsi pour souligner une
conscience floue d’Alors, révéler une Attente qui a déjà vécu maintes fois la confrontation au vide :
« Sur le seuil de la maison, ma mère m’ouvre
Ses bras. Baiser distrait, paroles en l’air
Et déjà l’aube me réveille démentant
Un à un, les espoirs de la veille »
L’inattention de l’adulte à l’essentiel et l’attente pure et purement déçue de l’enfant sont ici dépeints
de manière bouleversante. Comment ne pas sentir à la lecture du poème «Entre père et mère »
monter en soi les larmes d’un petit enfant qui y vit encore ?
La poétesse dépeint aussi, dans « Débroussailler les mots » une maladresse infantile à la conquête
d’une « noblesse » à laquelle l’Enfant est peut-être bien le seul à pouvoir prétendre. « Laissez les
petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le Royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent » dit Jésus dans la Bible.
L’enfant, qui tâtonne pour découvrir un monde promis et son langage n’est-il miroir à l’adulte
possiblement poète, « voyant » ? Le poème « L’enfant de l’aube » est d’ailleurs une référence
innommée à Arthur Rimbaud. L’enfant grandi est-il projeté face à une aube toujours insaisissable
composant son plus grand et plus vivant défi ? Là est peut-être concentrée la force régénératrice du
recueil « Cerceaux enchantés » qui invite à la résurrection du « regard singulier » ; sous la douceur
omniprésente de l’ouvrage émergent des flèches de feu : elles instillent l’urgence d’atteindre cet état
Autre de vie et de regard.
« Tant d’interrogations sous le feu des prunelles ! »
L’urgence n’est-elle pas, premièrement, de s’interroger sans cesse comme l’enfant rêvant
naturellement à un monde Bon. Un monde que l’érudition seule, l’agglomération de savoir, ne
sauveraient pas. Dans les poèmes du recueil « Les Cerceaux enchantés » on trouve à plusieurs
reprises la mise en scène d’un contraste entre le petit univers des devoirs scolaires et celui d’une vie
songeuse et brûlante d’une curiosité allant par-delà une connaissance pré-mâchée et imposée. Il y a
un appel fort à une connaissance plus totale et plus nourrissante, de l’ordre du Vital.
« Les arbres saluent d’un mouvement de têtes,
Les promeneurs tout étonnés. Ici tout prend un air de fête.
Les devoirs ennuyeux somnolent sur la table. »
L’arbre n’est-il le mieux approprié pour symboliser une création vivante en perpétuelle évolution ;
c’est le support (bien que de plus en plus remplacé par l’écran) de l’apprentissage et de l’écriture : les
pages vierges proposent des mondes toujours possibles. Or l’enfant distrait se trouve environné
d’innombrables pages aériennes où lire la vie et écrire son unicité.
Il ne s’agirait pas de déprécier la
valeur du « travail », qui ne cesse de « narguer » « la petite écolière », mais de voir toujours au-delà
de celui-ci une plus complète et libre inclination, dont il faudrait veiller à ne pas étouffer le délicat
flambeau. Malheur qui s’accomplirait sans doute, par exemple, en oubliant le pouvoir de l’abandon,
dont il est question, sans hasard possible, au sein du poème intitulé « L’étoile du berger » :
« L’étoile au bout d’un fil les guide en dormant
Au pays des roses immortelles et des sables mouvants.
Les enfants maintenant s’abandonnent à la nuit, ».
Je lis à travers les lignes imagées de ce poème les vagues profondes et incessantes d’une Foi qui
espère l’humanité, qui « n’achète rien, (et) ne vend rien », qui prononcerait silencieusement : «je
n’achète rien mais j’assiste à tous les spectacles / inattendus, je suis l’invitée de dernière minute. »
Si l’abandon est toujours voué à une insondable nuit qui effraierait sans sa condition remplie, ces
deux vers semblent apprivoiser cette étrangeté avec une justesse magistrale :
« Le noir est-il le miroir sans reflet des âmes attristées
Ou la nuance délicate d’une nuit à peine entrevue ? »
À la fin du recueil on invoque plus précisément des éléments naturels, par exemple, à deux reprises :
« les sycomores », « À l’ombre bleue des sycomores les arbres folâtrent ». Les sycomores ainsi
distingués sont des symboles à la fois de fécondité, d’éducation et de salut. Tout près d’eux dans le
poème Marie-José Pascal évoque « le langage immanent ». J’y vois le désir d’un rappel de la vie de
l’être à ses racines Silencieuses, à des introspections pures et fécondantes essentielles à l’évolution
de l’homme et à la société. Né humble, celui-ci retournera à l’humilité que garde le silence éternel.
Le visage émerge du silence pour y revenir au bout de l’expérience individuelle.
La poétesse dit en
effet au « Visage à déchiffrer » : « Tu appartiendras au silence et aux pierres sépulcrales ».
Il y a donc
là la conscience et l’acceptation cheminante que tout ce qui sort du silence revient au silence et au
« langage immanent » évoqué plus haut : une richesse que l’on goûte mais qui ne nous appartient en
fin de compte, ce qui ne peut empêcher d’une part de nous « un goût amer » ; toutefois provisoire
chez la poétesse grâce à « Ce vin de tous les âges qui nous permet d’aimer/ Dépassant les limites
parfois du raisonnable ».
C’est une invitation ! D’ailleurs « ce temps capricieux pourtant / contient
bien la fraîcheur de l’éternelle beauté ».
Et je ne peux que vous convier à retrouver celle-ci entre les pages de ce recueil « Les cerceaux
enchantés », lauréat du Grand Prix Poètes Sans Frontières 2022.
Marine Rose
Publié le
Préface du recueil Un Songe dans la Pierre
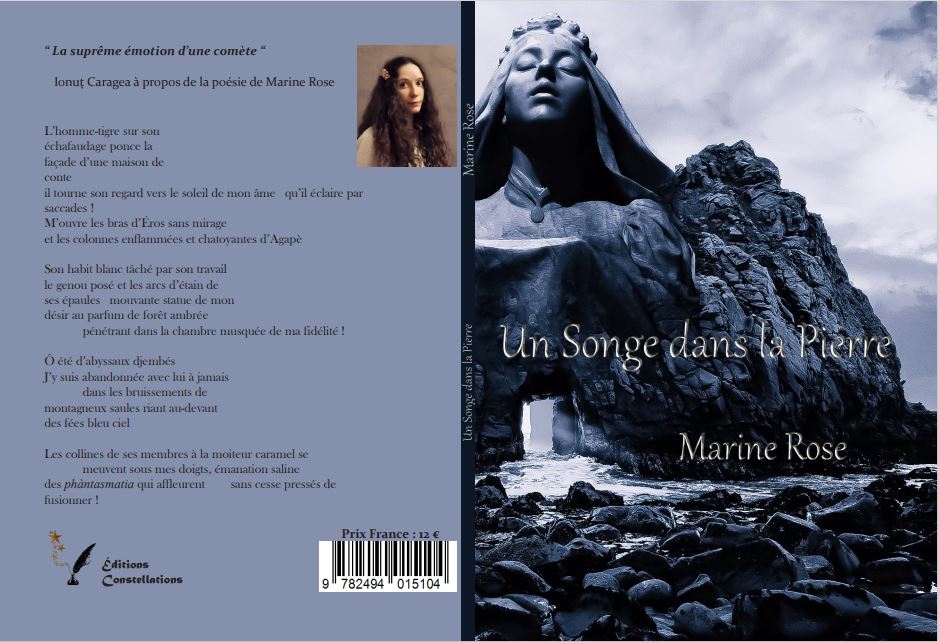
« Nous vivons dans l’impermanence, et bien que le sachant, nous nous laissons surprendre par le tranchant d’une réalité à laquelle nous voudrions nous soustraire. L’imperceptible transformation qui modifie, de seconde en seconde, l’état du réel, si on pénètre son flux, suffit à nous précipiter au cœur de la poésie, de ses sensations. La poésie et l’impermanence relèvent de la même fluidité.
Marine Rose dans Un Songe dans la Pierre fait surgir devant nos yeux des mots inapparents qui parviennent à réveiller des images, à soulever la métaphore, tout en n’en brisant pas le mystère. Ils maintiennent le poème dans la transparence auquel s’oppose le réel, plus opaque. Avec la poésie de Marine, nous entrons dans une bulle hors du temps, j’allais la décrire claire comme du cristal de roche, mais si je dois penser gemme, c’est la célestine que je dois évoquer, car la poésie éthérée qui nous est donnée à lire ici est plus proche de cette pierre qu’on appelle également « pierre des anges ». Elle éveille le sentiment d’union avec l’univers, et c’est exactement là que Marine tente de nous conduire.
Ce recueil nous fait évoluer dans une nature qui a tout du monde antique, où les fleurs seraient restées fraîches, où les pierres auraient conservé la mémoire des temps premiers, où l’air continuerait de vibrer de présences invisibles. Dans la douceur de ces instants poétiques, on se laisse fasciner par la lyre d’Orphée qui semble ressuscité dans le théâtre de la vie.
« La fantôme » évoquée page 60, respire elle aussi de façon subtile au travers du vivant :
«... Elle était libre / de sa chair violée par les / harmonies brisées elle n’avait / qu’à se pencher / sur un pétale pour en traverser le / bonheur sacré...»
Les mots papillons s’envolent et viennent nous effleurer sans qu’on les ait vus se matérialiser, sans qu’on sache d’où ils viennent.
Le chant lyrique s’intensifie du début à la fin du recueil, au point de réveiller la sensibilité des statues de pierre. Ce chant devient parfois baroque avec des saveurs exotiques, puis progressivement il s’élève, mystique. Jamais il ne cesse de vibrer d’amour. Au-delà de la confusion du réel, la poésie de Marine hisse la conscience du vivant jusqu’à la conscience cosmique. La lyre n’est-elle pas une constellation facilement identifiable dans le ciel d’été ? Le poète marche sur la corde raide qui lui permet de rejoindre le ballet des étoiles.
Marine nous fait rentrer dans son monde par une porte connue d’elle seule. Avec elle nous traversons un océan de pierres, nous apercevons « L’homme tigre sur son / échafaudage », il « ponce la / façade d’une maison de / conte ». Est-ce le monument du ciel qu’elle interpelle avec toutes les forces dont elle dispose, les sens en éveil, avec passion et volupté, en engageant toute sa personne sans réponse assurée ? Toutes les beautés, tout ce qui fait la vie ne peut se trouver répertorié dans un monument de pierre. Le vivant appelle ; veine, aorte, cœur qui bat, soupirs, oiseaux rocailleux de tes mains... Tout cela doit danser !
« Fragilité de l’homme sur les pierres historiques des cités » « Larme immense qui déracine l’être de tout ce qu’il pensait connaître ». Alors, « elle déversait son chant ignoré par le monde dans la coupe de l’émerveillement ». « L’entends-tu », l’homme, « forger sa douleur en colombe ? »
Et nous ne cessons de forger cette douleur jusqu’à atteindre le point d’espérance que seule la voie de l’amour peut situer. L’auteure a trouvé la sienne dans la cité des mots qui par sa ferveur ont fait éclater leur carcan de pierres et se sont envolées plumes. »
Carmen Pennarun
Publié le
L'innombrable miroir de la lyre d'Orphée
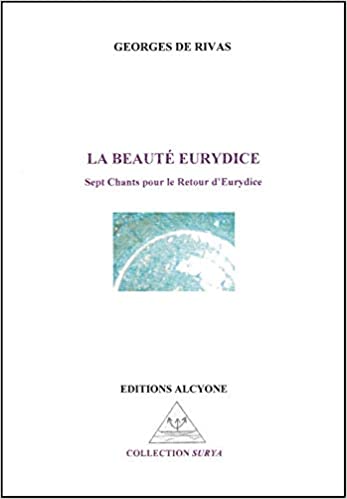
À l’origine, et si tout était unité immaculée de poésie, « nudité éthérisée » née de la lyre primordiale du Mystère ?
« Le langage dont Orphée usait a surgi au Commencement des âges/Son primordial éther sonore était la source de ce très haut lignage ». Dans La Beauté Eurydice de Georges de Rivas, si Orphée apparaît fondamental, il est aussi prophète du salut d’une humanité perdue. Ainsi est invoqué « le nom d’Orphée pour renouer le lien entre la terre et le divin ». Orphée, médiateur, est la voix d’un entre deux mondes : celui où rayonne sans discontinuer « la lumière incréée » de la divinité et celui où la « mort » règne et sévit.
Le premier monde est celui où vit l’être aimé entre tous, connaissance personnifiée et muse éternelle, Eurydice, « l’autel divin où (elle) demeure et (se) souvient ». Il est révélé par les voix ferventes des amants tel le pressentiment de l’absolue libération de la vie, de la conscience et de l’amour. Le voyant Orphée, « bohémien des nuées » refléterait ce « Ciel » comme une louange et un puissant appel à l’éveil adressé à l’humanité à laquelle il rappelle la présence d’un « monde où prend forme et vie le destin de toute chose sur la terre ». Cette source vitale et spirituelle est apprivoisée par un ton et un rythme propices à son suprême rayonnement : les phrases très longues et souples de la prose poétique ne laissent pas filer leur passion et semblent, en s’enchaînant, à la fois condenser et déployer leur élan euphonique: créant l’effet d’un vol qui ne retombe pas. La succession effrénée d’images mêle la surprise esthétique au jaillissement de sens sacré.
Orphée semble hanté par « le souvenir des eaux baptismales où nos âmes furent plongés par un ange solaire ! » il ne peut détacher son œil spirituel de cette contrée paradisiaque dont il est exilé, à la fois « dans la Constellation de la Lyre » et dans les limbes omniprésentes d’une terre mourante.
La vision du « Ciel » s’interpénètre à celle de la mort du monde d’ici-bas, suggérant la prophétie d’un dénouement entre douleur et lumière, semblable à une brûlure de phénix. Orphée est écartelé dans son émotion même, entre inaliénable splendeur et misère suffocante, en tant que témoin de l’état apocalyptique de notre monde.
« Mais ne sens-tu pas, ô Orphée que la Terre est aimantée par l’abîme, que l’Homme, mime des ténèbres, engendre la misère et tue la lumière de l’âme.
Ô pourquoi ne reviens-tu pas à cette étoile où Apollon te déposa ?
Vois la terre dévastée de schismes et de guerres, ensanglantée de crimes, vois la planète souillée, déforestée et qui agonise, bientôt carbonisée ! »
Le souffle de sa lyre emporte «Dame nature dans une morgue d’or noir » élevant le chant de sa détresse qu’il sublime, lui rendant hommage.
La souffrance de la planète, de l’être « dans ce musée climatisé où les hommes vont se terrer dans les prisons de leurs demeures informatisées » ne sont pas les seuls thèmes abordés et même Éros, dont la haute expression est abondamment remplacée par des ersatz souffre :
« Et qui entend ce cri du tigre royal à l’agonie sous ces feux de Bengale, Éros sacrifié sur l’autel lubrique de foutriquets au fantasme génital ? »
L’apocalypse est ici et d’après l’étymologie grecque du mot autant le démantèlement que la révélation nouvelle, suspendue aux lèvres du silence entier, celles d’Eurydice, «Eurudíkê » en grec, la grande justice. Orphée, la parole dialoguant avec le Silence, n’est-il conscience « christique » ? Il est conscience poétique au sens le plus absolu, que chacun aurait en soi – il faut bien un poète pour rendre un rayonnement de sa sublime voix, en esquisser le miroir entre Terre et Ciel et Georges de Rivas choisit de le faire sans détour – portail de rédemption et annonce de résurrection au sein de la tempête mortifère.
Marine Rose
Crittique publiée dans la revue Lettres Capitales le 8 février 2022
Publié le
Les amants de l'illumination
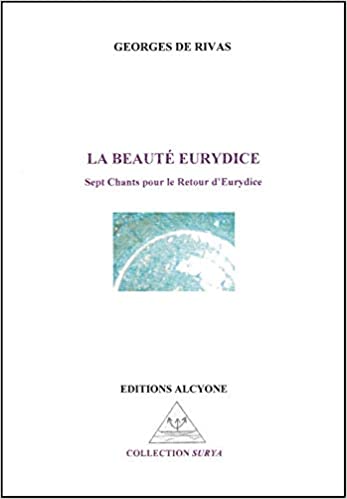
Sur les pas de Shakespeare, de Dante, s’inscrit La Beauté Eurydice de Georges de Rivas, un recueil imprimé sur papier pailleté de reflets adamantins aux éditions Alcyone, dont les vastes éclosions de vers mêlent une densité de rythmes élancés et de sonorités – qu’induit particulièrement une foisonnance rare de rimes intérieures, d’allitérations et d’assonances — à un certain sens de l’immensité.
Si pour Georges de Rivas l’horizon de la poésie est infini mystérique, il est aussi innombrable possibilité de trouver et d’aimer. Puisant en des références mythologiques, bibliques, cosmopolites et d’une esthétique pure – cependant, et je le souligne, jamais dénuée de reflets de signification, de symbolique –, le poète devient le génial interprète de la Source spirituelle dont il nous amène au cœur. La Quête et sa réponse sont omniprésentes, sous les traits de deux amants :
Orphée, le Voyant, laisse transparaître le poète lui-même, avec la véracité de son expérience mystérique. « Et l’ode que je chantais ne fut jamais révélée à l’oreille d’un mortel ayant perdu mémoire des songes de l’au-delà ».
La métaphore des oiseaux souligne la nécessité d’un éveil propice à l’illumination : « Mais j’ai vu mourir des oiseaux épuisés aux rives du fleuve-oubli » / « Or j’ai vu voler des oiseaux d’or sur des aubes chatoyantes peintes / par le sang des martyres et leurs âmes répandues en couleurs inouïes / chantaient autour d’une chaumière d’Inuits visitée d’aurore boréale »
Cette deuxième catégorie d’oiseaux – que l’on peut associer aux esprits – est teintée d’or, le symbole de la divinité révélée. S’adressant aux esprits qui pourraient le suivre dans le pèlerinage ailé de sa passion, le Voyant, par son ode, nous mène directement à la rencontre d’Eurydice, ou plutôt, de la Poésie divine personnifiée.
La splendeur que revêt celle-ci à son apparition est fidèle à ce qu’elle représente : « Je t’ai vue ô mon oasis Eurydice nimbée d’or et à la voix d’oaristys » // « Or voici que tu t’es endormie aux rives du futur / et demeures rêvant parmi les limbes au miracle / Muse de neige et d’un cortège d’augures / et mon cœur a suivi cette route pavée d’oracles »
Eurydice surgit drapée d’une esthétique sacrée prémisse de « miracle », elle est un astre dont les facettes de « Lumière-Amour » sont infinies. Elle est « muse auréolée du souvenir du divin séjour », « Beauté du lotus neigé par l’Éther », « Telle en son essence de ciel infuse au berceau des astres ». Contemplons plus précisément la révélation éblouissante de ces deux vers : « Tu passes, Femme-étincelle à une encre céleste amarrée / et déploie ton corps dans les essences de lavande violine ».
Au-delà de la beauté néphélibate des vers est renfermée l’essence symbolique des mots, propice à l’élévation : la lavande, qui charme par son arôme et sa couleur violine, nuance délicate du violet évoquant spiritualité et méditation, dévoile la pureté et la tendresse d’Eurydice. La « Femme-étincelle », qui embrase la passion, demeure « à une ancre céleste amarrée », ses bras ne pourraient être retrouvés qu’au cœur d’un foyer céleste, duquel elle semble, par ses apparitions d’entre les brumes de l’Inconnu, l’hôtesse.
La découverte d’Eurydice est orchestrée crescendo par une succession de ses facettes essentielles. En conclusion, Orphée dira d’ailleurs « Je ne puis me passer d’Elle » prouvant que la fantaisie de sa ferveur naît d’une pulsion existentielle.
À la douceur de l’apparition surnaturelle d’Eurydice succède sa vision sous l’angle du désir d’éveil, suggéré par cette image : « lotus et luth vibrant de beauté inouïe ! » Par-delà les sonorités et la vibration évocatrices, nous avons l’image du luth, dont Claude du Verdier a dit en 1585 : « La volupté prisée par-dessus toutes est celle / qui vient du luth, car l’oreille et l’esprit / contenter elle peut »
Il n’y aura pas de volupté plus haute à accomplir pour le désir que celle de « la seule plante levée au-dessus des eaux boueuses / et éblouissante, sortie du fleuve insomnieux de la nuit ».
La dryade Eurydice est Union-Absence : « Je suis habité par ta présence, oriflamme de l’Absence / tu es l’autel à sa divine flamme où s’allume mon âme ». Elle est ainsi évoquée de manière paradoxale : « abîme et cime de l’Être » et bien que décrite principalement sous les traits de la lumière elle paraît au dernier paragraphe en « Ombre immaculée ».
Enfin, alors qu’elle représente la source de poésie et son inspiration, il est aussi dit que ses « lèvres (sont) closes, cousues au fil d’or du profond silence. Éternelle présence et manque le plus élevé et le plus profond que le poète peut éprouver, la métaphore Eurydice est à l’image de Dieu.
Elle apparaît alors sous les traits d’une Quête mystique : « Je t’ai perdue deux fois dans les gouffres de l’Enfer et au Retour / tenant ta main, à l’orée du jour où mordorait la lumière d’Or ! / Or je t’appelle encore au-delà de la nuit du corps et de l’âme ».
Si la « nuit du corps » suggère les limites de l’incarnation, la nuit de l’âme quant à elle évoquerait l’épreuve des grands mystiques, le tunnel à traverser avant une Union totale. Le poète devra surplomber et transcender « la nuit du corps et de l’âme » autrement dit lui-même, par sa recherche sincère.
Car Eurydice est en conclusion « la porte du ciel », dont le poète nous offre la révélation, ou du moins ses vastes reflets, transcendant la mythologie par un mysticisme universel, réel, actuel.
Et l’on peut se demander, lorsque la voix d’Orphée se fait plus personnelle : « Muse où se reflète la Femme que j’aime », si le poète ne poursuit pas, à l’instar de Dante au Paradis de La Divine Comédie, en Eurydice, la présence céleste et transfigurée de la femme aimée, nous offrant l’éclat d’un duende à l’orée des contrées célestes.
Marine Rose
Crittique publiée dans la revue Le Litteraire le 7 février 2021